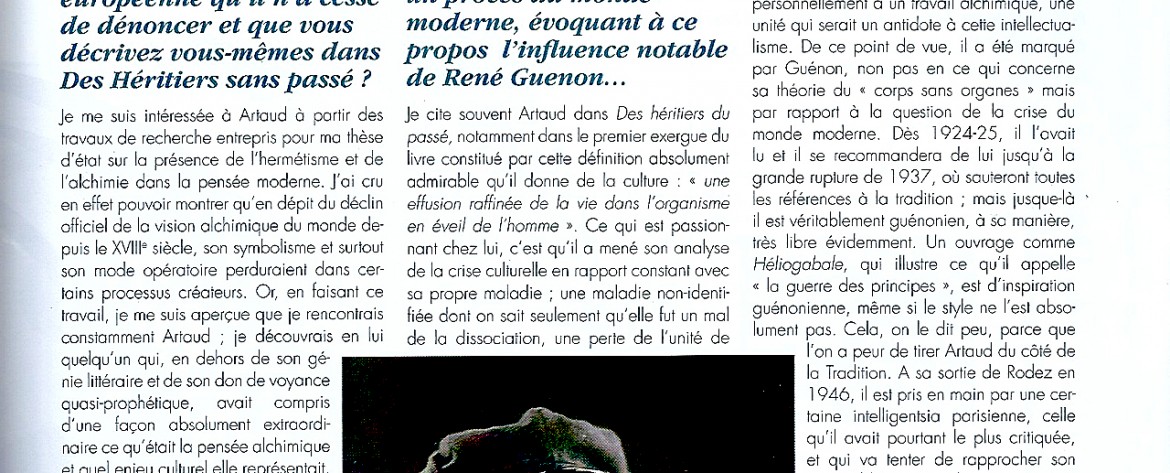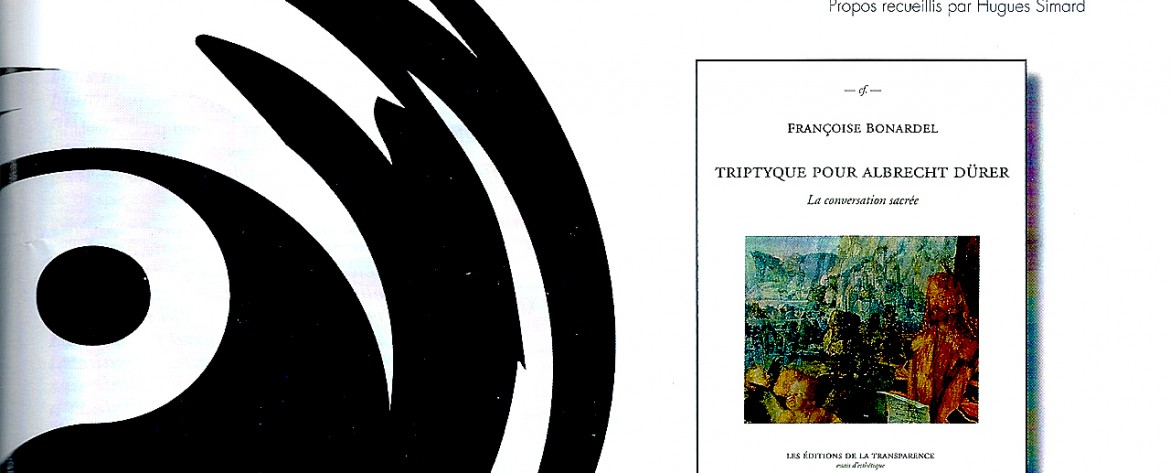Hugues Simard : Qu’est-ce qui vous a menée à vous intéresser à Artaud ? Existe-t-il un lien entre votre intérêt pour son œuvre et la crise de la conscience européenne qu’il n’a cessé de dénoncer et que vous décrivez vous-mêmes dans Des Héritiers sans passé ?
Françoise Bonardel : Je me suis intéressée à Artaud à partir des travaux de recherche entrepris pour ma thèse d’état sur la présence de l’hermétisme et de l’alchimie dans la pensée moderne. J’ai cru en effet pouvoir montrer qu’en dépit du déclin officiel de la vision alchimique du monde depuis le XVIIIe siècle, son symbolisme et surtout son mode opératoire perduraient dans certains processus créateurs. Or, en faisant ce travail, je me suis aperçue que je rencontrais constamment Artaud ; je découvrais en lui quelqu’un qui, en dehors de son génie littéraire et de son don de voyance quasi-prophétique, avait compris d’une façon absolument extraordinaire ce qu’était la pensée alchimique et quel enjeu culturel elle représentait. Il y fait très fréquemment référence dans son oeuvre, et cela jusqu’à la fin. Après avoir fini ma thèse, je suis donc revenue à lui pour creuser cette piste, et je ne fus pas déçue car je pense avoir mis en lumière une clef de lecture qui déverrouille véritablement tout une partie de sa pensée telle qu’elle s’exprime en particulier dans les Cahiers de Rodez puis ceux du retour à Paris. Jusqu’à aujourd’hui Artaud est ainsi resté un compagnon de route, quels que soient les sujets que j’ai pu aborder depuis, et je m’y réfère presque automatiquement. Il a été notamment à l’épicentre de cette crise de la culture que vous évoquez. On parle toujours d’Artaud comme d’un grand malade, ou à propos du théâtre ; mais il est également, en tant que poète, un penseur de la crise de la culture, quelqu’un qui a eu une intuition géniale des problèmes qui continuent de miner la culture occidentale.
H.S. : Vous avancez l’hypothèse que cette crise de la culture est avant tout un procès du monde moderne, évoquant à ce propos l’influence notable de René Guenon…
F.B. : Je cite souvent Artaud dans Des héritiers du passé, notamment dans le premier exergue du livre constitué par cette définition absolument admirable qu’il donne de la culture : « une effusion raffinée de la vie dans l’organisme en éveil de l’homme ». Ce qui est passionnant chez lui, c’est qu’il a mené son analyse de la crise culturelle en rapport constant avec sa propre maladie ; une maladie non-identifiée dont on sait seulement qu’elle fut un mal de la dissociation, une perte de l’unité de l’être. Celle-ci l’a sensibilisé à la dispersion mentale et spirituelle dont souffre la culture occidentale, compensant ce mal par un hyper intellectualisme. Depuis le Théâtre et son double, plus encore à partir de la seconde partie de sa vie, en 1937, Artaud sera amené à chercher dans le corps, ou plutôt dans un processus de « corporification » que j’associe personnellement à un travail alchimique, une unité qui serait un antidote à cette intellectualisme. De ce point de vue, il a été marqué par Guénon, non pas en ce qui concerne sa théorie du « corps sans organes » mais par rapport à la question de la crise du monde moderne. Dès 1924-25, il l’avait lu et il se recommandera de lui jusqu’à la grande rupture de 1937, où sauteront toutes les références à la tradition ; mais jusque-là il est véritablement guénonien, à sa manière, très libre évidemment. Un ouvrage comme Héliogabale, qui illustre ce qu’il appelle « la guerre des principes », est d’inspiration guénonienne, même si le style ne l’est absolument pas. Cela, on le dit peu, parce que l’on a peur de tirer Artaud du côté de la Tradition. A sa sortie de Rodez en 1946, il est pris en main par une certaine intelligentsia parisienne, celle qu’il avait pourtant le plus critiquée, et qui va tenter de rapprocher son incroyable aventure humaine et poétique de problématiques matérialistes et athées qui n’étaient pas profondément les siennes. Artaud n’est pas en ce sens moderne…
H.S. : Au point de faire de lui un antimoderne ?
F.B. : Oui à mon avis. la captation par les prétendues avant-gardes me parait être un contresens majeur. Artaud est antimoderne, je crois qu’on peut le dire. Les problématiques de la modernité, soit ne l’intéressent pas, soit lui paraissent pernicieuses, en particulier cet intellectualisme qui en est une des caractéristiques. La notion même d’intellectuel est insupportable à ses yeux, il ne s’est jamais considéré comme tel ; comme un poète oui, mais jamais comme un intellectuel. Cela dit, il n’est pas pour autant un traditionnaliste. On peut dire que jusqu’en 1936-1937, son lien avec Guénon aurait pu le faire annexer par ce courant de pensée mais ensuite, incontestablement pas. Il marche sur une voie qui n’appartient qu’à lui, dans laquelle il avance en solitaire et innove résolument. L’opposition tradition/modernité a eu du sens à une certaine époque de sa vie, elle n’en a plus ensuite ; ce qu’il cherche c’est alors justement son dépassement. C’est ce que je trouve passionnant chez lui : il est l’exemple type de quelqu’un qui a toujours pensé par-delà les oppositions, il a toujours eu un mode de pensée non-duel. Or, c’est celui de l’alchimie précisément, qu’on retrouvera aussi dans le bouddhisme, auquel je me suis également intéressée. Le fil conducteur de tout ce que j’ai écrit, c’est ce mode de pensée non-duel, cette pensée de la transmutation, de la métamorphose, en acte, « en corps », comme disait Artaud.
H.S. : Comment son œuvre se fait-elle justement l’instrument du dépassement des oppositions telles que Tradition/ Modernité, corps/esprit? Celui-ci s’opère-t- il de manière privilégiée à travers le théâtre ? Et en quoi cette opération est-elle alchimique ?
F. B. : En 1932, Artaud a écrit un texte intitulé Le théâtre alchimique, thème qui réapparaîtra en 1947 dans un autre texte, magnifique, lu à la galerie Pierre par Colette Thomas. On voit qu’il n’a jamais varié de ce point de vue. La scène théâtrale est un athanor, mais il y a chez lui une espèce de démultiplication des lieux puisque le creuset de la scène théâtrale renvoie également au corps de l’acteur.
Dès les années trente, dans le Théâtre de Séraphin et Un athlétisme affectif, Artaud montrait que la transmutation avait lieu dans le corps de l’acteur luimême. D’autre part, le théâtre est un microcosme dans lequel se joue la transformation de la culture, qui renvoie elle-même, surtout dans les derniers textes, à une espèce de grand procès qu’il fait à la Création. Il y a donc chez lui une multiplicité de lieux qui entretiennent un rapport analogique les uns par rapport aux autres. C’est sur plusieurs scènes à la fois qu’il met en oeuvre cette transmutation. S’il s’est acharné à refaçonner le corps durant ses années d’enfermement à Rodez, c’est afin de le rende incorruptible de telle sorte qu’il ne soit plus victime de ce qu’il appelle des «envoûtements», autant dire des prédations venues de l’être, de l’esprit, de tout ce qui est désincarné, de Dieu lui-même en tant que tel. Ce corps va être l’épicentre de toute une série de transformations qui affecte la Création. La grande obsession d’Artaud, c’était la hantise de la désincarnation. Tout ce qui n’était pas incarné était pour lui susceptible d’être vampirisé. Je pense moi-même également que toute notre culture est en train de basculer à travers le virtuel, vers une dématérialisation revêtant un caractère spectral.
H.S. : En quoi la remise en cause à laquelle il se livre rejoint-elle la vôtre ?
F. B. : Nous commençons à comprendre que la crise du nihilisme et celle de la modernité pourraient bien ne faire qu’une, comme l’avait déjà pressenti Nietzsche. Et comme cette crise ne va pas en s’atténuant mais que nous en vivons chaque jour davantage les effets délétères, il est peutêtre temps de remettre en perspective la notion de « modernité » de telle sorte qu’elle ne devienne plus soit un référent inutile dans la mesure où le moderne désigne simplement l’actuel, soit une référence idéologique dangereuse car interdisant de penser le présent. Je vois de plus en plus les limites et les dangers de l’idéologie moderniste, et si l’on continue à brader l’héritage culturel tout en s’attaquant maintenant au patrimoine biologique, c’est la notion même de culture qui va s’effondrer, tant du point de vue intellectuel que collectif. Pourquoi donc vouloir continuer à aller à l’école ? Laissons les enfants devant des ordinateurs à apprendre des programmes leur permettant le strict nécessaire pour s’adapter à un monde de plus en plus technicisé, industrialisé, prolétarisé. Pour ma part, j’essaie de rester un être de culture, de respecter ce qui m’a été transmis tout en exerçant ma liberté de pensée, de le transmettre à mon tour, et je suis de plus en plus consternée par l’inconsistance de ce que l’on appelle aujourd’hui culture : une sorte de minimum vital, de plus en plus minime et de moins en moins vital.
H.S. : Il y a aussi chez vous l’idée d’une troisième voie qui dépasserait l’opposition entre un mondialisme relativiste et le risque de repli sur soi inhérent à l’enracinement ?
F. B. : De ce point de vue, il faut absolument nous défaire des séquelles psychologiques causées par l’idéologie nazie. Nous combattons, avec raison, tout ce qui semble relèver de cet ordre. Mais à force de ne pas vouloir y ressembler, de chercher à nous en distancier, nous finissons par ne plus voir les problèmes qui sont les nôtres aujourd’hui. Simone Weil à la veille de sa mort a écrit un livre extraordinaire, d’un courage intellectuel incroyable, intitulé précisément L’Enracinement. Elle avait très bien vu que le grand mal du XXe siècle serait le déracinement. Quand on voit ce qu’a été la culture européenne, on réalise que l’enracinement n’a jamais été l’esprit de clocher, mais ce qui permet de se « former » et de laisser croître de grande culture sans une forme ou une autre d’enracinement, qui permet ensuite une ouverture sur l’universel. Le génie européen est est précisément d’avoir trouvé la formule permettant de passer du singulier à l’universel, et vice versa. Or, ce que l’on veut aujourd’hui, c’est couper toutes les racines, y compris biologiques. Il est grand temps de dépasser cette opposition cosmopolitisme/enracinement, d’autant plus que nous vivons un déracinement de plus en plus dramatique et que ce processus est en voie d’accélération. Il faut impérativement préserver cette conception européenne sans laquelle nous allons soit régresser vers la barbarie, soit devenir des colonisés, asservis aux puissances économiques et à des phénomènes que nous ne parviendrons plus à maîtriser.
H.S. : Vous avez également consacré un livre à Albrecht Dürer, en partant notamment de la célèbre gravure Le chevalier, la mort et le diable…
F. B. : J’ai pour cet artiste une passion comparable à celle pour Artaud ; pour son oeuvre mais aussi pour sa personne extraordinairement attachante, et plus généralement encore pour cette époque de très haute culture. Cet intérêt extrême m’a ainsi confronté à une période historique d’une particulière richesse, à la lumière de laquelle je me suis dit qu’il fallait absolument chercher à comprendre pourquoi nous n’en sommes plus là, pourquoi nous sommes au contraire entrés dans une période de décadence. J’ai donc écrit Des héritiers sans passé à la suite du Triptyque pour Albrecht Dürer. A moins de quatre siècles de distance, comment pouvons-nous en être arrivés à vénérer des choses d’une telle insanité, d’une telle laideur ou insignifiance ? En suivant à la trace la chevauchée du chevalier de Dürer dans l’imaginaire européen, je me suis aperçue qu’il drainait avec lui une très grande partie des préoccupations des penseurs européens. A travers cette figure emblématique, c’est aussi une certaine figure de la bravoure, du l’intrépidité, de la noblesse, qui fascina des créateurs comme Nietzsche, Wagner ou encore Thomas Mann. Cette figure chevaleresque ayant fini par incarner une grande partie de l’histoire de la culture européenne, l’envie de reprendre cette histoire à l’époque contemporaine tout en me disant qu’il fallait relever le gant, maintenir la flamme. L’attitude du chevalier face à ses deux adversaires, n’est pas l’affrontement mais l’évitement et la droiture. Peut-être est-ce au fond la meilleure stratégie qui nous est indiquée par cette simple mais admirable gravure, qui semble nous dire : « Ne perdez pas votre temps à essayer de les tuer, vous n’y arriverez pas, mais trouvez l’attitude juste qui va vous permettre de trouver votre chemin ».
Françoise Bonardel
Interview menée par Hugues Simard, parue dans Grandes Ecoles et universités magazine n°65, novembre 2014