Je remercie vivement Audrey Fella de m’avoir offert l’opportunité de rédiger pour le Dictionnaire des femmes mystiques des articles portant sur des figures non seulement très éloignées dans le temps mais à première vue si singulières qu’on pouvait les penser marginales, au point de parfois se demander si elles avaient vraiment été des « mystiques » ; question qu’on ne se pose pas quand on évoque les noms d’Angèle de Foligno, Catherine de Sienne, Thérèse d’Avila. Une chance donc, j’y insiste, car cela m’a contrainte à rechercher quels repères historiques, quelles données culturelles et critères spirituels, permettent d’apposer le qualificatif de « mystique » à des femmes aux personnalités si diverses, dont toutes n’ont pas de surcroît laissé une œuvre écrite témoignant de leur expérience spirituelle. Il me fallut donc tailler à chacune d’elles un vêtement sur mesure, si je puis dire ; certaines d’entre elles entrant probablement ainsi pour la première fois dans le Panthéon où trônent déjà depuis des lustres les grandes figures au regard desquelles nous pensons savoir, au moins à grands traits, ce qu’est une « femme mystique », et connaître du même coup les raisons pour lesquelles féminité et mysticité semblent si spontanément se répondre, jusqu’à souvent coïncider.
Chacune de ces notices renvoie donc indirectement à la question posée avec tant de force par Jean Baruzi dans l’immédiat après-guerre : Comment distinguer l’usage légitime du mot « mystique » de son emploi abusif, ou franchement dévoyé[1] ? Comment donc passer sous silence les présupposés qui pourraient orienter notre vision actuelle de la mysticité ? Disons que nous pourrions être aujourd’hui tentés par un certain irénisme, refusant sur ce point comme sur tant d’autres de distinguer aussi clairement que possible le vrai de ses contrefaçons ; et d’autant plus portés à céder à cette tentation que « l’élément mystique » a depuis quelques décennies trouvé à se loger là où on ne l’attendait pas – pensons à l’emploi de ce terme par Georges Bataille, ou même par Wittgenstein : non pas en marge du religieux, ou en son foyer le plus ardent comme le pensait Bergson, mais à sa place qu’il partage désormais avec des catégories tout aussi vagues – le divin, le sacré, le spirituel – à nos yeux capables d’accueillir le « numineux » et de le laisser rayonner à l’écart et à l’abri de toute distorsion cléricale, ecclésiale. Jadis évacuée aux périphéries parfois les plus suspectes du religieux, la mystique féminine bénéficie aujourd’hui d’un préjugé suffisamment favorable pour en occuper de plein droit le centre.
Le risque devait donc être envisagé, de projeter inconsciemment sur des figures féminines anciennes certaines des certitudes contemporaines concernant l’alliance, devenue pour nous quasi naturelle, de la féminité et de la mysticité ; et de tenir pour acquis le fait que l’écriture ait été pour ces femmes libératrice, au sens où elle leur aurait permis de découvrir et de laisser s’épanouir, fût-ce au prix du plus total renoncement, une identité brimée par des conventions sociales d’époque où nous ne voyons plus que préjugés. Que tant de mystiques aient été des femmes, alors même que si peu de femmes ont été des mystiques, ne saurait en tout cas conduire à féminiser à outrance la vie mystique au point d’y voir une « affaire de femmes », même si les femmes ont en effet donné à ce type d’expérience une coloration très particulière dont témoignent leurs écrits, au demeurant très divers quant aux genres littéraires auxquels on pourrait les associer : poèmes, confessions, autobiographie, plus rarement traités. Au terme de ce qui fut aussi pour moi une nouvelle expérience d’écriture, j’en suis toujours à me demander si j’ai davantage appris du « féminin » grâce à ces femmes mystiques, ou si c’est ce que je pensais savoir du féminin qui m’a conduite à les considérer comme d’authentiques mystiques.
Car la plupart des arguments communément employés pour prouver le caractère féminin de la mystique – sa dimension érotique, son irrationalité, son pathos exalté – se révèlent à double tranchant : si la femme est portée à l’extase mystique par sa réceptivité et sa totale disponibilité, comment expliquer qu’elle ait pu être dans le même temps si active – pensons aux fondatrices d’Ordres – et ses écrits souvent si clairs, si clairvoyants qu’ils ne pouvaient émaner de sa seule affectivité, fût-elle sublimée ? Comment donc rendre compte d’un rapport à l’écriture qui soit à la fois féminin et mystique ? Une autre difficulté d’autre part surgit en ce que l’élément scripturaire n’a joué aucun rôle dans la vie de certaines de ces femmes mystiques au rang desquelles on compte un nombre significatif d’illettrées – je pense par exemple à sainte Marie l’Égyptienne, que j’ai eu à traiter – ou qu’un rôle très secondaire dans l’aventure spirituelle de certaines autres.
Nombre de celles qui écrivirent eurent d’autre part à cœur de préciser qu’elles le faisaient contraintes et forcées par Dieu, sous la dictée de l’Esprit-Saint ou sur ordre de leur Supérieur(e), et non sans s’être ouvertes à leur confesseur de leurs scrupules à l’endroit d’une mission dépassant leurs faibles capacités, ou risquant de faire figure de tentation mondaine compromettant leur vie spirituelle. Ainsi est-ce par pure obéissance que Thérèse d’Avila se mit à écrire sa Vie, s’adressant ainsi à Sa Majesté (Dieu) : « Je le supplie du fond du cœur de m’accorder la grâce de composer en toute clarté et sincérité cette relation que me demandent mes confesseurs[2].» Ce qui n’interdit évidemment pas aux lecteurs de s’apercevoir que certaines d’entre ces femmes mystiques écrivaient fort bien, sans être pour cela forcément des écrivains.
C’est aussi pourquoi la notion même de « littérature », rapportée à l’expérience mystique, suggère de distinguer non seulement deux types d’écrits mais de rapports à l’écriture venant soit de femmes engagées dans la vie contemplative à qui Dieu octroie certaines « faveurs « exceptionnelles dont tentent de témoigner leurs écrits – mais est-ce alors véritablement de « littérature » qu’il s’agit ? Soit de femmes-écrivains – je pense à la poétesse Kathleen Raine, et à Catherine Pozzi – dont les aspirations spirituelles, la sensibilité hors du commun et l’univers personnel appellent le qualificatif de « mystique » : mais n’est-ce là qu’une appellation demeurée littéraire, ou l’acte d’écrire a-t-elle servi de vecteur à une transformation intérieure faisant de ces femmes-écrivains d’authentiques mystiques ? C’est donc toujours la question de l’authenticité qui resurgit, qu’il s’agisse du vécu ou de l’écrit qui le traduit ; cette exigence de clarification et d’authentification risquant de rester sans réponse lorsqu’une femme écrivain, volant de ses propres ailes, ne se reconnaît aucune appartenance religieuse précise mais puise, au gré de son inspiration du moment, dans le patrimoine spirituel de l’humanité, comme c’est souvent le cas aujourd’hui. Est-ce alors de « mystique sauvage »[3] qu’il faut parler, ou de la mysticité comme d’une nébuleuse aux contours incertains ?
Il va en tout cas de soi qu’on ne saurait traiter de manière exactement similaire ces deux types d’écrits ; les premiers s’inscrivant presque toujours dans une tradition religieuse en dépit de leur apparente marginalité ou de leur caractère transgressif, à mon sens très largement surévalué par certains de nos contemporains – je pense bien sûr à Georges Bataille ; et les seconds donnant à la littérature une autre dimension, une autre portée que purement littéraire, sans qu’il soit toujours possible de déterminer si c’est là un apport extérieur, une sorte d’effraction du monde profane par l’Esprit-Saint, en somme ; ou un mouvement pour de bon transgressif venu du langage lui-même et des possibilités insoupçonnées qui sont les siennes ; un simple « effet de langage » peut-être même, comme on aimait à le penser dans les années 70. Quel regard fallait-il donc prioritairement porter sur les uns et les autres de ces écrits ? Fallait-il s’intéresser surtout à la qualité incontestablement « littéraire » de nombre des témoignages rédigés par ces femmes mystiques, ou prendre surtout en compte l’intensité supposée indescriptible de leur vécu, et se contenter de ce que l’écrit en suggère, plus qu’il n’en dit ?
C’est en effet devenu une sorte de lieu commun d’assimiler le vécu mystique à l’incapacité de pleinement dire, décrire, transcrire dans toute sa splendeur l’éclat d’une présence qui semble ne s’offrir que pour endeuiller à jamais l’âme qui l’a un instant entraperçue, côtoyée, touchée parfois. Ainsi Michel de Certeau donne-t-il le ton dès les premières lignes de La fable mystique en parlant d’« un deuil inaccepté, devenu la maladie d’être séparé, analogue peut-être au mal qui constituait déjà au XVI° siècle un secret ressort de la pensée, la Mélancholia[4] ». Mais quel crédit accorder à l’ineffabilité supposée d’une expérience suscitant au demeurant tant d’écrits dont l’abondance ne serait alors qu’une tentative de réponse, toujours insatisfaite, à un tel manque ? Cette ineffabilité semble il est vrai s’accorder avec le caractère extatique de l’expérience mystique ; et ce caractère paraît à son tour corroborer la propension très féminine à l’abandon de soi, quitte à ce que cet abandon donne lieu à une exhibition des affres et extases si spectaculaire qu’on n’a pas manqué d’y voir un symptôme « hystérique ». N’est-ce pas plutôt qu’en valorisant l’ineffabilité du vécu mystique on accrédite implicitement la nécessité de cette surenchère verbale et l’extériorisation, corporelle et spectaculaire, de ce qui échappe à l’écrit ? Quand Wittgenstein note que « ce qui peut être montré ne peut pas être dit[5] », et assimile cette incompatibilité à l’émergence de l’élément mystique, il ne dit pas autre chose.
Même si l’on récuse aujourd’hui les thèses réductrices très en vogue au siècle dernier – hystérie, érotomanie, régression infantile – il n’en demeure pas moins que l’ineffabilité porte potentiellement en elle ou l’obligation de faire à jamais silence, ou cette surabondance verbale tentant en vain de combler, par son propre excès, l’inadéquation pathétique entre un Dieu absent et une âme transie d’amour pour Lui. Suscitée, nourrie et attisée par l’appel d’air d’un désir toujours inassouvi, l’écriture se déploie alors dans l’espacement créé par le délaissement de Celui à qui la femme mystique s’est vouée sans partage. Il s’en faut de beaucoup cependant que toutes ces femmes aient vécu sur le même mode émotionnel et affectif cet écart allant de l’esseulement à l’écartèlement ; et la tension sauvage d’Angèle de Foligno revivant dans sa chair la Passion du Christ n’a pu s’écrire de la même manière que le consentement presque serein d’Hadewijch d’Anvers, inventant le néologisme « présence d’absence » pour désigner l’écart incommensurable entre « ce qui est saisi et ce qui fait défaut », mais vouant son écriture à la louange inconditionnelle de l’Absent dont elle est éprise : « Je ne suis ni chagrinée ni troublée qu’il me faille écrire, puisque Celui qui vit prodigue ses dons parmi nous, et que nous informant de nouvelle clarté il veut nous instruire. Qu’il soit béni en tout temps et en toute chose ![6] »
Mais comment celle qui a consenti à devenir à son corps défendant le scribe de l’Esprit Saint ne serait-elle qu’une amante délaissée parmi tant d’autres ? Comment pourrait-elle s’en tenir à l’ineffabilité de ce qu’elle sent, entend et voit, quand elle sait par ailleurs être une oreille, un regard et une main élus pour voir, entendre et dire ce que pressentent au mieux les autres êtres humains ? On finit donc par se demander si l’insistance avec laquelle certaines de ces femmes mystiques répètent à l’envi que ce qu’elles écrivent n’est rien au regard de ce qu’elles vivent, n’est pas d’abord une sorte de rappel finalement assez convenu de la distance qu’elles estiment devoir maintenir entre la grâce qui leur a été faite, et qui produit en elles ses effets, et l’indignité qu’elles pensent être la leur en tant que créatures pécheresses, et plus encore en tant que femmes. Une concession beaucoup plus théologique et sociologique en somme, que littéraire. Car en matière de « littérature », on est au contraire frappé par l’extraordinaire talent de ces femmes à exprimer l’inexprimable.
J’en suis donc venue à me demander si l’intérêt trop exclusif porté à cette rhétorique de l’indicible, sur laquelle insistent tant de commentateurs à commencer par Bergson, n’était pas pour une part une vision masculine, ou plutôt une vision émanant de l’anima masculine qui, si elle est vécue comme une fonction inférieure, tend à se percevoir elle-même à travers des images à la fois dégradées (dégradantes) et sublimées, incandescentes et éthérées. D’où ma question : jusqu’à quel point les femmes mystiques se sont-elles identifiées à la vision que les hommes leur renvoyaient d’elles-mêmes ? Auraient-elles tant écrit si le Logos, défaillant, avait été en elles totalement supplanté par l’Eros, sublimé mais tout-puissant ? C’est aussi pourquoi ce constat de Michel de Certeau demanderait à être explicité : « Sans doute, pour des raisons à élucider, l’expérience féminine a mieux résisté à la ruine des symboliques, théologiennes et masculines, qui tenaient la présence pour une venue du Logos[7]. »
Si l’expérience féminine, dans sa double dimension mystique et littéraire, a en effet mieux résisté à la ruine progressive du Logos dont la modernité occidentale a été le théâtre, c’est sans doute qu’elle ne s’est pas contentée de lui substituer l’Eros mais a bel et bien entrepris, du point de vue féminin qui est le sien, de faire dialoguer de manière jusqu’alors inédite Eros et Logos. Peut-être sa relative relégation sociale a-t-elle également protégé la femme de trop s’interroger sur la fonction elle aussi ambiguë de son animus, sans lequel elle n’écrirait pas. Mais écrirait-elle comme elle le fait – c’est-à-dire « au féminin » – si elle n’était capable de s’ouvrir, grâce à l’Eros, à une dimension infra ou métalogique du Logos qui, loin d’être tout bonnement « irrationnelle », inspire une autre forme de cohérence que celle construite par l’esprit masculin, inspiré ou hanté par son anima ? Plutôt que de subversion du Logos par l’Eros mieux vaudrait sans doute parler de révélation, grâce à l’Eros vécu au féminin, de certaines possibilités inexplorées du Logos.
Car ce qui frappe, dans le discours de la plupart des femmes mystiques, est autant l’évocation d’une souffrance et d’une jouissance à la fois intensément vécues et toujours différées, et une volonté d’exactitude quant au choix des mots susceptibles de n’en pas trahir la qualité : « Ainsi l’âme aime en tout le discernement », écrivait Hildegarde de Bingen[8]. Le lecteur ne peut donc que constater la superposition déconcertante d’une rhétorique pantelante entremêlant souffrance et jouissance et appartenant en effet au registre de la passivité ; et d’un souci de précision quant à l’énoncé que ces femmes se sentent tenues de formuler compte tenu du rôle de « secrétaires » de l’Esprit Saint qu’elles ont consenti à assumer : « Que le Dieu tout-puissant daigne aussi oindre de l’huile de sa miséricorde cette pauvre figure féminine qui a été l’intermédiaire de cet écrit ! [9] » S’il est vrai, comme l’affirmait Ezra Pound, que « la grande littérature n’est que du langage chargé de sens au plus haut degré[10] », alors le langage mystique est « littéraire » au suprême degré. C’est même là, de la part de ces femmes, une préoccupation d’autant plus étonnante que l’écrivain qui est en elles a d’avance renoncé à toute position d’auteur, et à combler le vide laissé par le signifié absent – Dieu, le Christ, l’Aimé – sans pour autant se complaire dans une stylistique maniériste et esthétisante. C’est aussi ce qui distingue à mon sens, quoi qu’on ait pu en dire, le discours mystique de celui de la « déconstruction » post heideggérienne, conduisant à qualifier de « mystiques » des expériences existentielles d’ordre extatique, ou des postures d’évitement ou de déni sans rapport réel avec la dimension foncièrement apophatique du témoignage mystique.
Contrairement aux idées reçues – y compris par les philosophes, reléguant souvent la mysticité aux confins extrêmes de la rationalité (Ricœur) – les mystiques, hommes et femmes sur ce plan confondus, font en général preuve d’un remarquable discernement tant quant aux illusions qu’il leur faut déjouer face aux pièges tendus par le Malin, qu’aux conditions permettant au langage de reprendre ses droits sur l’extase durant laquelle le ravissement suspend en effet temporairement toute capacité d’expression, comme l’a montré en fine analyste Thérèse d’Avila : « Quand l’âme a des visions ou entend des paroles de ce genre, ce n’est jamais, à mon avis, dans le temps où elle est unie à Dieu par le ravissement ; car alors […] ses puissances sont complètement perdues en Dieu ; elle ne peut alors, à mon avis, ni voir, ni entendre, ni écouter [11] » ; et pas davantage écrire, raconter ce qu’elle a vu ou entendu, faut-il ajouter. Peut-être est-ce pour avoir trop exclusivement assimilé expérience mystique et vécu extatique que l’on en arrive si rapidement à la conclusion que « la parole meurt absolument », comme le disait Angèle de Foligno à propos du récit des « choses divines et de leurs influences[12]». Sans doute les mystiques les plus visionnaires ne rencontrent-elles pas non plus les mêmes difficultés d’expression que les mystiques extatiques ; la relative clarté de pensée des premières tenant pour beaucoup à la radiance des images qu’il leur est donné de visualiser, là où les secondes risquent toujours d’être submergées par la passion et de ce fait incapables d’une formulation articulée, sensée. Ce pourrait donc être la nature du rapport entre pathos et vision qui détermine qu’il y ait ou non possibilité d’expression.
Mais ne peut-on également envisager que cette disposition « mystique » de l’âme, cette tournure si singulière d’un être à la fois extra lucide et pâmé, naisse pour partie au moins de l’écriture elle-même ? J’entends par là de l’ascèse qu’elle induit tant quant au choix des mots, acteurs d’une « justification » drastique, qu’à une épuration du langage comparable à celle pratiquée sur leurs sensations et visions par les femmes mystiques. Sans doute n’est-ce pas l’écriture qui a, à soi seule, déterminé la vocation « mystique » de Cristina Campo ou de Simone Weil, mais un examen plus attentif de leur rapport à l’écriture montrerait que le langage fut pour toutes deux la matière première d’un affinement et d’un effacement de soi ; Campo se comportant en « alchimiste » extrayant la quintessence des phrases et des mots quand Weil, remplissant à longueur de journée d’une écriture appliquée les pages de ses Cahiers, tentait ainsi d’élimer le « moi » qu’elle portait comme un fardeau. La mysticité littéraire a elle aussi ses styles, aussi différents que le baroque l’est du cistercien ; chacun d’eux révélant lui-même de quelle manière l’écrivain reçoit du langage le surplus de sens faisant de lui un(e) « mystique » : comme une source intarissable à laquelle il s’abreuve, ou comme l’éclair dont il lui faut d’abord conjurer le foudroiement s’il veut en recevoir la lumière ?
On ne peut donc exclure que la pratique de la langue puisse dans certaines conditions révéler « l’élément mystique » dont Wittgenstein affirmait qu’il ne se montre qu’à défaut d’être exprimable par des mots[13]. Serait-ce là l’aspect le plus spécifiquement féminin de l’aventure scripturaire de ces femmes, à la fois mystiques et écrivains ? Avoir rendu crédible qu’un écrivain ne soit pas qualifié de « mystique » du seul fait des préoccupations spirituelles qui sont les siennes et du style dans lequel il est parvenu à les exprimer ; ou bien encore de sa capacité à extraire de la langue une quintessence rare et précieuse, mais en raison de l’effet puissamment libérateur que son écriture est capable de susciter dans l’âme – la sienne et celle du lecteur – qui ne se sent plus tenue de choisir entre monstration et expression ; la monstration devenant elle-même expressive, et l’expression revêtant la chair qui manque si souvent aux formulations théologiques ou philosophiques : « Je suis le signe sans interruption », disait Angèle de Foligno[14].
Je vois donc pour ma part dans ce Dictionnaire des femmes mystiques la confirmation de l’importance de l’élément « féminin » dans la vie mystique, bien sûr ; mais aussi de ce que le « féminin mystique » se révèle étonnamment créatif quant aux mille et une manières de repousser les limites imparties au Logos et d’en subvertir, grâce à la dimension « érotique » de l’expérience unitive, la vocation purement intellective et contemplative.
Conférence donnée le 6 avril 2013 lors du colloque sur « la mystique féminine » (Centre Sèvres, Paris)
[1] J. Baruzi, « De l’emploi légitime et de l’emploi abusif du mot ’mystique’ », L’intelligence mystique, Paris, Berg International, 1985, p. 51-58.
[2] Sainte Thérèse de Jésus, Vie écrite par elle-même, Œuvres complètes, trad. du R. P. Grégoire de saint Joseph, Paris, Seuil, 1949, p. 16.
[3] Michel Hulin, La mystique sauvage, Paris, PUF (« Perspectives critiques »), 1993.
[4] M. de Certeau, La fable mystique 1, Paris, Gallimard (« tel »), 1982, p. 9.
[5] Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, trad. P. Klossowski, Paris, Gallimard (« tel »), 1961, p. 53 (4.1212).
[6] Hadewijch d’Anvers, Écrits mystiques des Béguines, trad. Fr. J.-B. P., Paris, Éditions du Seuil, 1954, p. 133.
[7] M. de Certeau, La fable mystique, op. cit., p. 15.
[8] H. de Bingen, Le Livre des œuvres divines, trad. B. Gorceix, Paris, Albin Michel, 1982, p. 86.
[9] H. de Bingen, op. cit., p. 215.
[10] E. Pound, Comment lire, trad. Ph. Mikriammos, Paris, Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2012, p. 25.
[11] Sainte Thérèse de Jésus, Vie écrite par elle-même, Œuvres complètes, op. cit., p. 255.
[12] A. de Foligno, citée dans Textes mystiques d’Orient et d’Occident choisis et présentés par S. Lemaître, Paris, Plon, 1955, t. II p. 187.
[13] L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, op. cit, p. 106 : « Il y a assurément de l’inexprimable. Celui-ci se montre, il est l’élément mystique » (6. 522).
[14] A. de Foligno, Le livre des visions et instructions, trad. E. Hello, Paris, Seuil (« Points Sagesses »), 1991, p. 95.

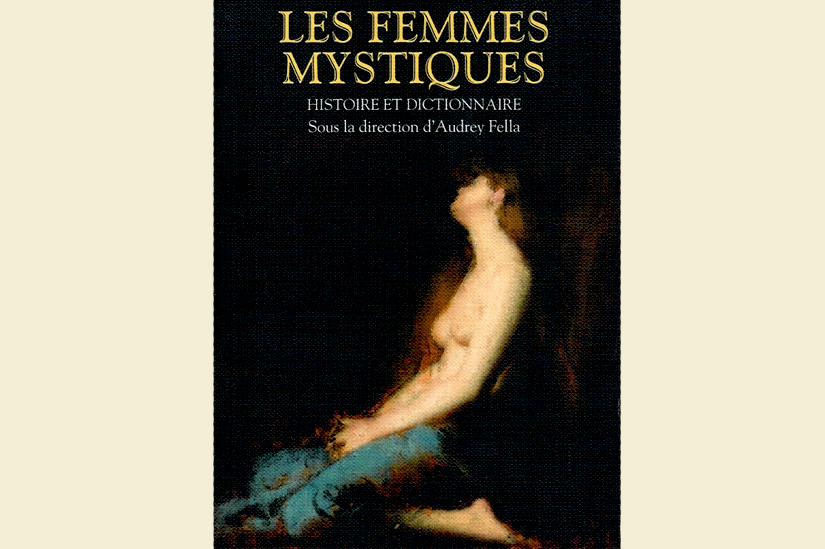

Bonjour Madame.
L’article est très bien, merci!
Par contre, C’est bizarre remarquer que les références sont plutôt masculines…
Je voudrais vous demandez quelques indications de ouvrages contemporains sur le sujet 🙂
Je vous remercie,
Maite Dietze